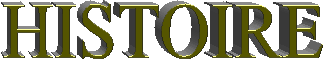
Il se dit que Charles le Chauve a établi son camp à Thury, sur la colline du Roichat, lors de la bataille de Fontenoy.
*La bataille de Fontenoy
Pour la plupart des Français la
bataille de Fontenoy
évoque la victoire
remportée en 1745 dans le Hainaut par
le maréchal de Saxe,
non les combats que se livrèrent,
neuf siècles plutôt,
à Fontenoy en Puisaye et aux alentours de Thury les petits-fils de Charlemagne,
qui provoquèrent le partage de l'empire et la naissance de la
France.
Louis le Pieux, à sa mort,
laissait trois fils : Lothaire,
l'aîné, prétendait au titre
d'empereur que ses frères, Louis
et Charles, lui
contestaient. Le 21 juin 841, il avait amené
ses
troupes dans la plaine de Fontenoy tandis que celles
de Louis et de Charles, venues d'Auxerre par la voie
romaine, campaient autour de Thury. Leur état-major s'installa au sommet d'une colline qu'on appelle aujourd'hui
le Roichat, d'où il pourrait suivre les péripéties de la bataille très loin
alentour.
Lothaire,
pour laisser à l'armée de son neveu et allié, Pépin, qui avait franchi la Loire
à Gien, le temps de le rejoindre, avait feint de vouloir négocier, mais
lorsqu'elle fut en vue, il somma ses frères de le reconnaître pour empereur ou
de se soumettre, par la bataille, au jugement de Dieu. Le 25 juin, les armées
s'affrontèrent en un combat qui dégénéra vite en carnage. Lothaire, après avoir
failli un moment l'emporter, dut s'enfuir devant la cavalerie de Charles le Chauve.
Au soir de la bataille on compta des milliers de morts. Cent mille, selon les
contemporains qui ont, il est vrai, très exagérément grossi leur nombre. Mais
l'émotion que suscita cette bataille et les traces qu'elle laissa longtemps
dans les mémoires en un temps où l'on était pourtant habitué à côtoyer la mort
violente, disent assez qu'elle fut sans doute une des plus sanglantes du
Moyen-Age, alors que les armées qui s'affrontaient alors dépassaient rarement
quelques centaines d'hommes et que les morts se comptaient à peine par
dizaines. « Et tant y en eut d'occis de chaque côté que mémoire ne recorde mie
qu’il y eut oncques en France si grande occasion de chrétiens. »
Des
sarcophages, mais aussi des squelettes de combattants hâtivement enterrés sans cercueil,
ont été souvent mis à jour en différents lieux de la bataille. De nombreux
toponymes, à Thury et aux alentours, évoquent encore cette journée : la Fosse
aux prêtres, la Fosse aux gens d'armes, Fougilet, déformation apparue au XIIe
siècle de Fosse Gilet, la vigne des cercueils, à Sougères, la vallée de la
fuite, la vallée de la défaite, les Cris, la queue Louis, le Roichat - pour le
Roi Charles -, etc... etc...
La motte de Gémigny
C'est
sans doute au cours du XIe siècle que l'on vit s'élever dans la
paroisse une motte de terre rapportée, au sommet de laquelle on construisit un
« château », c'est-à-dire une tour en bois comprenant la résidence du châtelain
et le logement des gardes, qui constituait une défense contre les agresseurs
éventuels ou une base d'où partaient les incursions vers les châtellenies
voisines. C'est l'époque des guerres privées. Devenant de plus en plus
indépendants des comtes, les châtelains se livrent entre-eux de petites guerres
que les interdits de l'église limitent mais ne suppriment pas, et dont les
manants font les frais.
Autour
de la motte, la basse-cour, sur laquelle s'élèvent les dépendances du château
et les logements des serviteurs, a la forme d'une grande couronne limitée par
un fossé circulaire et un rempart de terre surmonté d'une palissade faite de
pieux et de branchages. C'est à l'abri de cette fragile construction que les
villageois se réfugient en cas de danger. Le village de Gémigny existait-il
quand fut élevé le château ou fut-il fondé plus tard par des colons venus
chercher des terres à défricher à son ombre rassurante ?
Au
siècle dernier, au climat des « Brotteaux », on voyait encore au centre d'un
cercle de quarante mètres de diamètre que formaient les fossés, cette
motte-.que le père de M. Maurice Sansois se rappelait avoir escaladée étant
enfant, avec d'autres gamins du village. Il était là quand, vers 1870, on
l'avait arasée. Une partie des fossés, à demi-comblés, sont toujours visibles
aujourd'hui.
***
C'est
d'abord sur des manses, libres ou serviles, plus ou moins étendus, comprenant
la maison, les bâtiments d'exploitation et les terres nécessaires à sa
subsistance que réside la famille patriarcale. Mais celle-ci va commencer à se
dissocier au cours du XIIe siècle quand l'accroissement des surfaces
cultivables dû aux défrichements, augmentant le besoin de main-d’œuvre, la fait
apparaître comme un frein à l'expansion. C'est en même temps l'éclatement des
manses auxquels succèdent, moins étendues et plus nombreuses, les « masures »
poyaudines que leurs pères aient aliéné jadis au profit du « dominus », en
échange de sa protection, leur liberté et la propriété éminente de leurs biens
pour n'en garder que l'usufruit, ou que des terres à défricher leur aient été
concédées, les tenanciers paient pour leurs tenures un cens fixe, en argent ou
en nature, et des rentes proportionnelles à la récolte, qu'on appelle
indifféremment en Puisaye champart ou tierces.
Les
serfs sont assujettis à la taille à merci qui varie au gré du seigneur, les
vilains à une taille « abonnée », fixée une fois pour toutes, et que l'érosion
monétaire rendra, au fil des ans, de moins en moins pesante. Pour l'usage du
moulin, du four ou du pressoir où ils sont astreints à porter leurs grains,
leur pain ou le produit de leurs vignes, ils paient des droits en argent ou en
nature. Ainsi les habitants de Grangette, quand ils utilisent le fout
seigneurial, laissent un pain sur seize. Il est encore d'autres taxes et droits
de toute sorte : lods et ventes, tonlieux, péages, etc... Il y a la dîme que
l'on doit à l'église, quand elle n'est pas inféodée à des laïcs. Il y a les
corvées, mais elles tendent à s'espacer et deviennent moins contraignantes, ou
elles sont remplacées par une redevance.
Le
servage régresse sensiblement dans la plus grande partie du royaume en raison
des affranchissements largement octroyés au cours des XIIe et XIIIe siècles et quand il
survit - comme il arrive souvent dans le Nivernais -, la condition du vilain et
celle du serf se sont tellement rapprochées que c'est moins à leur statut qu'à
l'étendue de leurs tenures qu'on les différencie.
Le
XIIIe siècle voit s'effriter le pouvoir seigneurial au profit de
celui du Roi. L'utilisation du fer améliore l'outillage - les forges se
multiplient dans les forêts de Puisaye - contribuant à accroître le rendement
des terres. Le niveau de vie du paysan s'améliore en dépit de l'apparition de
l'impôt royal qui s'ajoute à toutes les redevances qu'il paie déjà au seigneur.
Le sobriquet, que chacun portait sa vie durant, souvent fait placé au patronyme
héréditaire.
Grange Seiche
En 1314 les religieux de l'abbaye
de Reigny avaient affermé à Jehan des Grangettes moyennant 80 bichets de
froment, 20 de seigle, 100 d'orge et 100 d'avoine « la grange et territoire de
Grange Seiche», une métairie « assise et située en la paroisse de Soyères
(Sougères) et lieux circonvoisins » sur laquelle ils s'étaient établis au XIIe siècle. Elle s'étendait sur
350 arpents de terres à blé particulièrement fertiles, à l'emplacement de ce
qui avait été autrefois une riche villa gallo-romaine.
En
1403, en pleine guerre de Cent ans, les villages de Puisaye sont en partie
abandonnés. Jehan Souchon, de Thury, obtient un bail de six ans pour 40bichets
de froment, 40 d'avoine et deux de pois, mais bien que ces conditions soient
bien plus avantageuses que celles qui avaient été consenties à Jehan des
Grangettes près d'un siècle plus tôt, le fermier ne renouvellera pas son bail.
Sans doute a-t-il déserté la paroisse à son tour avec les derniers habitants
avant qu'il soit expiré.
Les
plaies de la guerre sont loin d'être refermées en 1481. Les nouveaux habitants,
fraîchement arrivés de différentes provinces, sont très clairsemés ; leur
nombre est sans rapport avec celui de leurs prédécesseurs, avant la grande
peste de 1348. La difficulté reste grande de trouver un laboureur susceptible
d'exploiter un domaine aussi important que celui de Grange Seiche. C'est
pourquoi les clauses du « bail à plusieurs vies » que passent les religieux de
Reigny avec Jehan Pijon, déjà fermier de la sergenterie et du péage de Thury
sont si intéressantes pour le preneur : six livres de rente - soit quatre
deniers par arpent - outre dix sols tournois au comte de Dam-martin, seigneur
des pays de Puisaye, et, pour les religieux de Saint Père, le paiement de trois
bichets de froment, trois de seigle et trois d'orge, rendus en leurs greniers
d'Auxerre, symbolique survivance de la dîme que leur versaient jadis les
religieux de Reigny. Quand le fermier meurt, en 1508, le bail est reconduit aux
même conditions en faveur de sa veuve, de son fils et d'Estienne Breuler,
demeurant lui aussi à Thury, «
moyennant que lesdits preneurs, femme et enfants, tenants et possédants,
seraient tenus de construire et édifier une maison bonne et convenable audit
lieu comme il sied à un bon laboureur, dedans cinq ans »
Cependant,
au fur et à mesure que croît la population, les baux deviennent moins
avantageux pour les nouveaux fermiers, mais les religieux ne pouvaient modifier
les clauses de celui qu'ils avaient dû consentir lorsque Grange Seiche était
encore en broussailles. Il leur fallut attendre l'an 1536 pour obtenir de
François Ier' des lettres royales qui les autorisaient à dénoncer ce bail.
Grangette et Colangette
En
1982 l'apparition fortuite dans l'église de Moutiers de peintures murales des
XIIe et XIVe siècles dissimulées sous un badigeon depuis
deux siècles et demi, puis les travaux entrepris pour les dégager sous
l'impulsion intelligente du maire, M. Solano, des « Amis de Moutiers » et de M.
et Mme Pélissier qui, infatigablement inventorient le patrimoine de la Puisaye,
ont replacé ce ravissant petit village au premier plan de l'actualité poyaudine
L'histoire
de Grangette et de Colangette, deux hameaux de la paroisse de Thury, est
étroitement liée à celle de Moutiers, ou, plus précisément à celle de son
prieuré dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques rares vestiges. Ce petit
monastère, fondé vers l'an 700, devenu prieuré, fut rattaché au IXème
siècle à l'abbaye de Saint Germain d'Auxerre.
En1335, Adeline, dite « la Basse
demoiselle», et Guillaume Sceau, écuyer, fille et gendre de feu Philippe Le
Bas, faisaient aveu à l'Abbé pour plusieurs héritages sis à Grangette et
Colangette qu'ils tenaient de lui en fief. Ces deux hameaux avaient pour
seigneur l'aumônier du prieuré de Notre-Dame de Moutiers, religieux de l'abbaye
de Saint Germain
Au
début du XVe siècle, l'abbé Jehan de Nanton commit au gouvernement
du prieuré, moyennant deux cents livres de rente, le frère Jehan Boursier, mais
son successeur, l'abbé Bérul, en 1427, alors que la Puisaye était désolée par
la guerre, les disettes et les désertions, révoqua le malheureux religieux que,
bien injustement, il tenait pour responsable de sa ruine.
«
Par sa faute et coulpe... le lieu d'iceluy où il avait bonne et notable place,
bien fortifiée et bien tenable... par défaut de bonne garde, est a été détruit,
et aussi les autres édifices et héritages à iceluy appartenant comme les prés
et terres en friche et en ruine, et les vignes en déserts, les moulins abîmés
et détruits, les étangs rompus et en tel état que le lieu est demeuré inhabité
et inhabitable. »
Le four banal
Le
four banal de Grangette était situé entre le crot et le grand chemin commun. L'aumônier
de Moutiers l'avait affermé à Georges Morin moyennant 75 sols par an en 1494.
Les habitants étaient contraints d'y faire cuire leur pain en laissant au
fermier en paiement un pain sur seize. En 1517 le frère Antoine de la Chapelle
s'inquiétait du coût des charges que représentait son entretien « tant en
maison, bois et autres choses » qui lui étaient nécessaires et craignait
qu'avec le temps il pût « venir et demeurer en décadence, d'autant que les bois
sont forts abîmés et défrichés autour d'iceluy », De plus, la servitude et
charge du four dissuadaient les familles étrangères de venir s'installer dans
le hameau et d'y édifier des maisons pour le plus grand profit de la
seigneurie,
«
Voulant gouverner selon les commandements de Dieu et considérant que les
saintes écritures disent que quiconque délie ses sujets de la servitude obtient
du souverain Juge relaxation de ses délits et péchés, considérant leur
obédience en bonne intention, et aussi le profit de l'église et de la
seigneurie», il affranchit, mainmise et délia perpétuellement pour eux, leurs
hoirs, lignées, générations et postérités tous les habitants de Grangette Il
leur donnait « permission et puissance de faire édifier un ou plusieurs fours
en leurs maisons et d'y cuire leur pain dorénavant toutes et quantes fois il
leur plairait » pourvu toutefois qu'ils s'engagent, eux, leurs hoirs,
successeurs et ayants-cause, et tous ceux qui tiendraient feux et ménages, pain
et sel, à Grangette, à payer chacun an au jour Saint André cinq sols tournois
au seigneur et à ses successeurs. Ainsi, le bon frère, par cet
affranchissement, s'assurait, outre la rémission de ses péchés, un revenu plus
élevé que le prix du fermage sans assumer à l'avenir les charges du four
***
C'est
seulement le 15 avril 1710 que Grangette et Colangette furent vendues, avec
Banny, situé dans la paroisse de Saints-en-Puisaye, par l'abbaye de Saint
Germain à Jean-Baptiste du Deffand et à Charlotte-Angélique Nicolas de Biseuil,
son épouse, pour la somme de 4000 livres dont les acheteurs devraient payer les
intérêts au denier vingt (5 %) en argent et non en billets, jusqu'au règlement
du principal qui ne pourrait intervenir avant quarante années. Tous les hameaux
qui formaient avec le bourg la paroisse de Thury étaient désormais placés sous
l'autorité d'un seul seigneur.
*Source:
livre de M Pierre Bourgoin "Thury Un village de Puisayeé"
Voie romaine Auxerre-Entrains
Elle est encore
visible sur les territoires de Thury et de Sougères.
Il y a 6000 ans, les
hommes cultivaient déjà le blé à Thury. Comment le sait-on ? A cause d’un
outil de cette époque-là qui a été trouvé sur le territoire de la commune. Il
servait à broyer les céréales. En 1669, Louis XIV confirme la décision de
François 1er d’autoriser un marché le mardi de chaque semaine et trois foires
par an à Thury.
Un document de 1790
indique que les marchés du district sont approvisionnées en blé par Thury et
qu’il faut en conséquence réparer le chemin de la Malrue à Saint Sauveur, ce
qui souligne immédiatement la différence entre Forterre et Puisaye.
Thury revendique son
appartenance à la Forterre, bien qu’à une époque le village ait porté le nom de
Thory-en-Puisaye.
Thury-en-Forterre n’en
travaille pas moins en bonne intelligence avec ses voisins de Puisaye, et cela
depuis longtemps.
Administrations Carte de visite et économie Célébrités Curiosité
Informations et annonces Loisirs Photos Traditions Vos suggestions